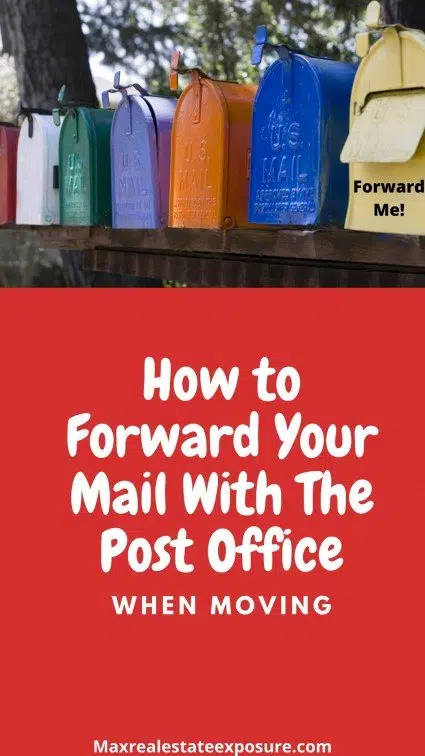En France, l’utilisation de l’eau de piscine pour l’arrosage du jardin n’est pas explicitement interdite, mais elle s’accompagne de recommandations strictes. Les eaux traitées au chlore ou au brome sont soumises à des seuils précis pour ne pas nuire à l’environnement. Pourtant, certains propriétaires continuent de détourner ces règles, espérant limiter le gaspillage.
Le Code de la santé publique encadre le rejet des eaux de piscine, notamment pour éviter la contamination des sols et des nappes phréatiques. Des pratiques inadaptées peuvent entraîner des conséquences inattendues sur la flore et la faune locales.
Pourquoi l’eau de piscine pose question au jardin
Les premiers rayons de soleil poussent à chercher des alternatives pour économiser l’eau, ce bien commun devenu rare. Recycler l’eau de piscine pour l’arrosage du jardin intrigue autant qu’elle inquiète. Derrière cette envie de réutiliser, se cachent de véritables doutes sur la compatibilité de cette eau avec la nature du jardin.
L’eau de piscine ne ressemble ni à l’eau de pluie ni à celle du robinet. Elle concentre chlore, brome, sel ou oxygène actif : rien d’anodin pour les végétaux. Même à faible dose, le chlore ne distingue pas entre bactéries indésirables et micro-organismes utiles. Les plantes du jardin et la vie du sol subissent alors des effets collatéraux, parfois invisibles mais bien réels. Les vers de terre, précieux alliés de la fertilité, ainsi que de nombreux micro-organismes, payent le prix fort.
En arrosant avec l’eau de la piscine, on introduit dans la terre des résidus qui bouleversent l’équilibre biologique du sol. Voici concrètement ce qui suscite l’alerte des spécialistes :
- La présence résiduelle de chlore ou de brome, qui suffit à freiner la croissance de végétaux délicats.
- Le bouleversement du pH du sol, modifiant la capacité des racines à absorber les minéraux essentiels.
- Le risque de salinisation lié aux piscines au sel, dommageable pour nombre d’espèces non adaptées à un excès de sodium.
L’impact de l’eau de piscine au jardin n’est donc pas anecdotique. Derrière un geste qui semble anodin, c’est toute la santé de l’écosystème domestique qui est en jeu.
Quels sont les risques réels pour les plantes et la biodiversité ?
Arroser les plantes du jardin avec de l’eau de piscine bouleverse la vie du sol, parfois sur le long terme. Les produits chimiques nécessaires à l’entretien de l’eau, chlore, brome, sel, ne ciblent pas que les microbes indésirables. De nombreuses plantes, surtout les jeunes pousses, les aromatiques ou les feuillages fragiles, supportent mal même de faibles quantités de ces agents désinfectants.
Le sol héberge une microfaune discrète mais indispensable : vers de terre, bactéries, champignons. Tous interviennent dans la décomposition de la matière organique, la fertilité et la bonne santé des végétaux. Or, un apport répété d’eau de piscine perturbe ce monde invisible. Les micro-organismes, sensibles aux substances oxydantes, finissent par disparaître, laissant un sol moins vivant et moins fertile.
Le problème ne s’arrête pas là. L’arrosage avec une eau chargée en désinfectant peut faire varier le pH du substrat. Acidité ou alcalinité, peu importe la direction : dès que l’équilibre se rompt, les racines peinent à tirer profit des éléments nutritifs. Les symptômes ne tardent pas : feuillage pâle, croissance au ralenti, floraison limitée.
Enfin, la biodiversité locale subit elle aussi les conséquences. L’eau qui s’écoule vers les zones sauvages du jardin peut toucher amphibiens, insectes ou oiseaux. Leur cycle de vie, leur reproduction ou leur alimentation peuvent en être affectés, parfois durablement. Utiliser l’eau de piscine pour arroser suppose donc de mesurer la fragilité de l’équilibre entre plaisir esthétique du jardin et respect de la vie qui l’habite.
Précautions et astuces pour arroser sans danger avec l’eau de la piscine
Avant de songer à recycler l’eau de piscine pour l’arrosage, il faut impérativement contrôler la teneur en chlore, brome ou oxygène actif. Pour cela, les kits d’analyse, bandelettes colorées ou testeurs électroniques, offrent une mesure fiable : le chlore doit descendre sous 0,1 mg/L pour éviter de fragiliser les plantes. Il est préférable d’utiliser une eau qui n’a pas reçu de traitement chimique depuis plusieurs jours.
La filtration n’est pas à négliger. Faire passer l’eau par un filtre à sable ou une pompe de filtration permet d’éliminer une partie des particules indésirables. Transvaser ensuite dans une citerne ou un réservoir de récupération laisse le temps aux dépôts de se poser et aux agents volatils, comme le chlore, de s’évaporer naturellement.
Certains jardiniers avertis ajoutent du thiosulfate de sodium pour neutraliser les derniers résidus de désinfectant. Ce geste protège la microfaune du sol et limite les déséquilibres biologiques.
Pour appliquer l’eau sans agresser les racines, privilégiez un système goutte-à-goutte ou un asperseur. L’eau s’infiltre lentement, sans inonder la terre. Ciblez les plantes établies et robustes, tout en évitant les jeunes pousses, les potagers ou les aromatiques.
Après chaque apport d’eau de piscine, surveillez le pH du sol. Si besoin, corrigez avec des amendements naturels pour préserver la vitalité du jardin, même en cas d’utilisation exceptionnelle de cette ressource.
Des gestes simples pour protéger son jardin… et la planète
Face à la pression sur les ressources, l’arrosage raisonné s’impose, tout particulièrement quand les restrictions d’eau se multiplient dans l’Hexagone. Plutôt que d’utiliser l’eau du robinet ou de recycler systématiquement celle de la piscine, il existe des alternatives naturelles à privilégier. La récupération de l’eau de pluie reste la solution la plus respectueuse pour l’équilibre du jardin.
Voici quelques pistes concrètes pour intégrer ces pratiques facilement :
- Mettez en place une citerne de récupération ou un récupérateur d’eau de pluie au pied de vos gouttières pour stocker l’eau gratuitement.
- Utilisez des engrais naturels pour renforcer la résistance des plantes face au manque d’eau.
- Réservez l’eau de piscine au nettoyage de la terrasse ou pour l’arrosage ponctuel de massifs d’ornement résistants, jamais pour le potager ou les jeunes plantations.
Arroser le soir ou à l’aube limite l’évaporation. L’eau du robinet, souvent calcaire, ne convient pas à toutes les espèces végétales. L’eau de pluie, plus douce, respecte l’équilibre du sol et soutient la microfaune.
Adopter ces gestes simples, accessibles à tous, permet de préserver la ressource et de garantir un jardin vivant. Utiliser l’eau de piscine, même avec toutes les précautions, reste une solution de dernier recours. Quand tout est fait pour respecter la vie du sol et la biodiversité, le jardin n’a rien à craindre : il continue de s’épanouir, saison après saison, sous la vigilance de ceux qui le cultivent.